Générations de médecins : la passion comme dénominateur commun
Une interview avec le Docteur Emmanuel Agneessens (61), radiologue et maître de stage, et le Docteur Sylvain Guillaume (32), radiologue.
Je suis radiologue et maître de stage. À mes côtés, Sylvain, radiologue à ses débuts. Ensemble, nous voyons chaque jour comment le métier évolue — et comment les générations se croisent, se questionnent, s’enrichissent mutuellement.
Dr. Emmanuel Agneessens
Trois générations, trois façons d’exercer
Emmanuel Agneessens : « Je fais partie de ce qu’on appelle parfois la génération sacrificielle. Celle qui a tout donné à la médecine, sans compter les heures. Travailler soixante heures par semaine, c’était normal. Notre vie tournait autour des patients, de l’hôpital, du service.
Puis est venue une génération intermédiaire, celle des années 2000, avant le Covid. Elle a commencé à chercher un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée — sans toujours y parvenir, car le cadre administratif et hospitalier restait très rigide.
Et enfin, la nouvelle génération. Celle qui cherche du sens. Le travail reste essentiel, mais il n’est plus l’unique pilier de la vie. La famille, les loisirs, la santé mentale… tout cela compte aussi. Ils bousculent les codes, questionnent les horaires, les réunions du soir, l’organisation. Ils osent dire : “Pourquoi ne pas revoir notre manière de fonctionner ?” Et franchement, je trouve cela plutôt sain. »

Le métier évolue, et c’est une bonne chose
D’après l’enquête : Les jeunes médecins généralistes à temps plein (moins de 40 ans) travaillent en moyenne 48 heures par semaine, soit moins que leurs aînés. Les médecins âgés de 40 à 55 ans travaillent en moyenne 53,5 heures par semaine, tandis que ceux de 56 ans ou plus atteignent 55,5 heures hebdomadaires.
Sylvain Guillaume : « Je comprends parfaitement cette évolution. En radiologie, notre travail ressemble parfois à celui d’un bureau : des shifts, des gardes bien définies, un rythme soutenu, mais encadré. On sait quand la journée commence et quand elle se termine. Et je trouve ça très bien.
Aujourd’hui, on ne vit plus le métier comme avant. Les jeunes médecins veulent séparer le professionnel du personnel. C’est presque une question de survie.
La société a changé. Le coût de la vie a explosé, les deux membres du couple travaillent. Ce n’est plus le même monde qu’il y a trente ans. Alors oui, quand je suis à l’hôpital, je veux que mon travail ait du sens, qu’il soit reconnu. C’est une autre vision du métier, mais elle n’enlève rien à la passion.
Il faut être lucide : le regard de la société sur les médecins a changé. Autrefois, le médecin avait un statut, une forme d’autorité naturelle. Aujourd’hui, le rapport est plus horizontal. Le patient est informé, parfois revendicateur, et la médecine est quasiment devenue un service. Cela modifie notre rapport au travail. Dès lors, difficile d’accepter de faire toujours plus d’heures, toujours plus de réunions, sans reconnaissance supplémentaire. On veut de la clarté, de la flexibilité. C’est légitime.
Et puis, dans certaines spécialités, comme les urgences, le rythme reste dicté par la demande. En radiologie, c’est différent : le service tourne de manière constante, ce qui permet une meilleure répartition. Chaque spécialité a ses contraintes, ses défis, mais au fond, nous partageons tous la même volonté : bien faire notre travail, et continuer à aimer ce que nous faisons. »
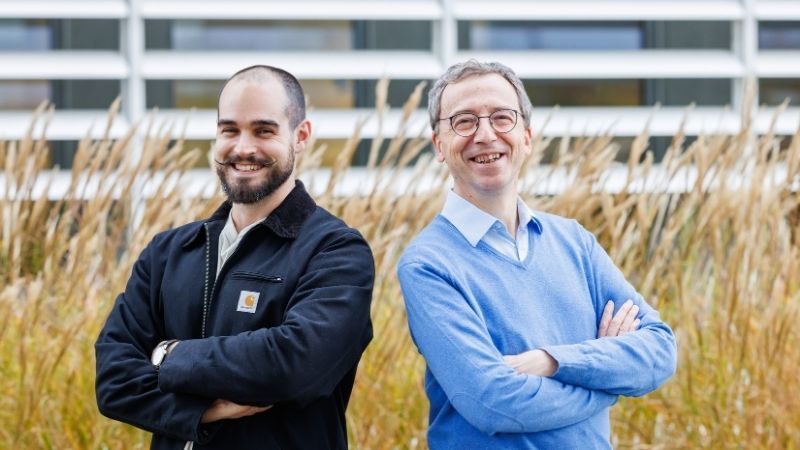
Une charge de travail qui change de visage
D’après l’enquête : 78 % des médecins généralistes et 76 % des dentistes de moins de 40 ans déclarent ressentir une pression de travail élevée ou très élevée. Ces pourcentages sont nettement plus élevés que ceux des médecins généralistes (58 %) et des dentistes (47 %) de 56 ans et plus.
Emmanuel Agneessens : « Je constate souvent, en tant que maître de stage, que les jeunes médecins ressentent aujourd’hui une charge de travail plus lourde. Certains disent que cela vient de l’organisation actuelle du travail ; d’autres pensent que les nouvelles générations sont simplement moins tolérantes à la pression. À l’époque, un jeune médecin pouvait enchaîner des gardes de 48 heures sans sourciller.
La réglementation a beaucoup évolué depuis ma formation, et c’est une bonne chose : la loi encadre désormais les horaires, et nous veillons à ce qu’ils soient respectés. Mais dans certaines spécialités, notamment la chirurgie, ce cadre légal pose un vrai défi. L’INAMI impose un nombre précis d’actes à réaliser pour valider la formation ; or il devient difficile d’atteindre ces quotas tout en respectant les limites horaires.
En radiologie, c’est plus gérable : il faut un certain nombre de scanners, d’échographies ou d’IRM sur cinq ans, dans différentes disciplines. Mais pour d’autres, c’est plus complexe. Le système est devenu très rigide.
Et pourtant, en radiologie — comme la médecine en général, on apprend aussi par l’observation, par l’échange avec les plus expérimentés. Le compagnonnage reste essentiel : c’est en voyant des dizaines de cas similaires qu’on apprend à “sentir” une pathologie. Ce savoir empirique, difficile à formaliser, est mis à mal par un canevas trop strict. Cela dit, cette évolution répond tout de même à certains excès du passé. »
Une éthique de travail différente, mais la même passion
D’après l’enquête : Les médecins, tous âges confondus, reconnaissent que les différentes générations ont une éthique de travail différente. Près de 80 % le confirment. Ainsi, la jeune génération parle plus facilement de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Seuls 38 % des médecins de 56 ans et plus abordent ce sujet, contre 55 % chez les médecins de moins de 40 ans.
Emmanuel Agneessens : « Dans votre enquête, près de 80 % des médecins reconnaissent qu’il y a des différences entre générations : autrefois, certains travaillaient sans relâche, 60 ou 80 heures par semaine, alors qu’aujourd’hui, on parle davantage d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Pour ma part, je ne pense pas que l’éthique des jeunes ait changé. Leur passion, leur engagement et leur respect du patient restent intacts. Ce qui a évolué, c’est la manière d’exercer. Le métier a profondément changé, dans toutes les disciplines. On assiste davantage à une forme de “consommation médicale”, où le temps et la relation sont parfois mis sous pression. »
Sylvain Guillaume : « Nous avons beau appartenir à deux générations différentes, je crois que nous partageons une chose essentielle : la passion. Elle prend peut-être des formes différentes — plus raisonnée chez les uns, plus équilibrée chez les autres — mais elle reste le moteur. Et tant qu’il y aura cette passion-là, le dialogue entre générations continuera d’enrichir la médecine. »
Burn-out et perte de sens
Sylvain Guillaume : « Aujourd’hui, on ressent fortement le poids de la médecine défensive : on multiplie les examens, parfois sans réelle pertinence clinique, simplement pour se protéger du risque médico-légal. C’est frustrant, chronophage… et cela fait perdre du sens au travail. Cette perte de sens, nous la voyons chez beaucoup de confrères et aussi chez de jeunes médecins qui n’achèvent pas leur formation. Le burn-out n’épargne personne. On en parle plus facilement qu’avant, mais cela reste difficile à admettre : un médecin n’aime pas dire qu’il ne va pas bien. On apprend parfois qu’un collègue est absent sans savoir pourquoi, avant de découvrir plus tard qu’il s’agit d’un épuisement professionnel. »

La féminisation du métier change la donne
Emmanuel Agneessens : « Quand j’ai commencé mes études, les promotions comptaient environ 60 % de garçons pour 40 % de filles. Aujourd’hui, c’est l’inverse : il y a environ 70 % d’étudiantes. Et cela change inévitablement la dynamique du métier.
Les femmes jonglent souvent entre leur vie professionnelle et leur vie de famille. C’est un vrai défi d’organisation pour tout le monde. »
Sylvain Guillaume : « C’est aussi pendant l’assistanat que beaucoup décident de fonder une famille, parce que c’est le moment le plus propice. On est encore sous un régime proche du salariat, ce qui offre une certaine stabilité. Après, quand on devient indépendant, ce n’est plus pareil.
Une grossesse pendant la formation, c’est tout à fait normal évidemment, mais cela interrompt parfois la courbe d’apprentissage. Certains reprennent à 100 %, d’autres non — c’est du cas par cas. Le vrai enjeu, c’est la flexibilité du système pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme. »
Se remettre en question grâce à la jeune génération
Emmanuel Agneessens : « Former de jeunes médecins, c’est passionnant. Ils arrivent avec un regard neuf et parfois, ils bousculent nos habitudes. Ils me demandent : “Pourquoi fais-tu comme ça ? Pourquoi ne pas essayer autrement ?” — et c’est profitable. Cela nous pousse à réfléchir, à évoluer. Il y a parfois des frictions, bien sûr. Trois jeunes assistants sont arrivés dans mon service, deux sont partis ailleurs pour des raisons d’organisation. Si on ne se remet pas régulièrement en question, on risque de perdre de jeunes talents. »
Sylvain Guillaume : « De notre côté, on apprend énormément des plus anciens. Leur expérience est précieuse. Dans notre service, on discute beaucoup, on partage les cas intéressants et c’est ça qui rend le travail enrichissant.
Il faut juste trouver un équilibre : adapter les méthodes sans renier ce qui fonctionne. La médecine évolue sans cesse, et cette tension entre générations, c’est aussi ce qui la fait progresser. »
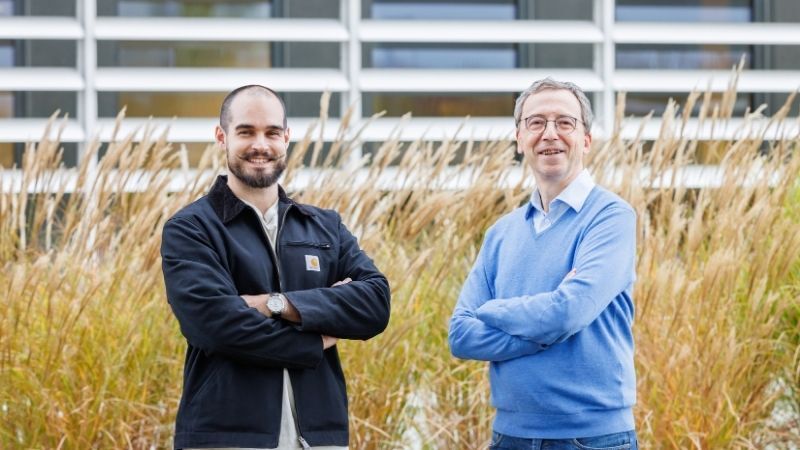
Le poids administratif : un défi commun
Sylvain Guillaume : « Ce qui pèse aujourd’hui, surtout dans les autres spécialités (médecine générale…) c’est toute la partie administrative autour de la pratique médicale. Les mails, les codes, les formulaires, les formations obligatoires pour rester accrédité… tout cela grignote le temps médical pur. On passe un certain temps à remplir des documents, à suivre des formations pour rester en conformité, notamment sur la radioprotection. C’est important, mais épuisant. »
Emmanuel Agneessens : « Oui, on ne s’en rend pas toujours compte, mais ce travail invisible prend une place considérable. Cela alourdit la charge mentale et laisse parfois moins de place à l’essentiel : le contact humain. »
Le dialogue, plus fort que la confrontation
D’après l’enquête : La grande majorité des médecins estime que la collaboration entre plusieurs générations est un atout.
- 74 % préfèrent travailler en équipe avec plusieurs collègues.
- 79 % jugent très importante l’expérience et les connaissances des collègues plus âgés.
- 72 % sont convaincus que les nouvelles générations de médecins apportent un regard neuf sur la profession.
Emmanuel Agneessens : « Les jeunes médecins nous obligent à nous remettre en question, je vois dans la collaboration entre générations une vraie richesse. Les jeunes médecins arrivent avec un regard neuf sur le métier. Ils nous demandent parfois : “Pourquoi travaillez-vous de cette façon ?”, et ces questions nous bousculent. Cela nous pousse à revoir certaines habitudes, à repenser notre organisation. Et honnêtement, ce n’est pas plus mal !
Les jeunes apportent aussi des connaissances actualisées, une autre approche du travail, une exigence de flexibilité et de cohérence. Et puis la médecine évolue sans cesse : chaque nouvelle génération arrive avec un bagage scientifique que nous n’avions pas forcément à leur âge.
Pour moi, la clé, c’est le dialogue. Dans notre service, on parle beaucoup : des cas, mais aussi du fonctionnement, des idées nouvelles. C’est ce qui permet d’éviter les malentendus. Travailler ensemble, c’est se parler — pas se confronter.
Et au-delà du service, il y a un autre enjeu : la reconnaissance du métier. Pendant le Covid, tout le monde applaudissait les soignants. Aujourd’hui, on a l’impression que cet élan est retombé. Les jeunes médecins, comme les infirmières, ressentent ce paradoxe : on valorise la mission, mais on ne leur donne pas toujours les moyens de la remplir. Cette frustration, je la comprends. C’est pourquoi il faut plus que jamais entretenir le dialogue, pour avancer ensemble, malgré les différences d’âge et de parcours. »
Sylvain Guillaume : « Entre générations, il faut savoir échanger, écouter et mettre un peu d’eau dans son vin. Dans notre service, on a la chance d’avoir une belle dynamique entre générations. Les plus anciens partagent leur expérience : notamment sur la gestion des situations complexes. C’est ce qui rend notre métier passionnant. En retour, nous, les plus jeunes, apportons une autre façon de voir les choses, plus connectée à l’évolution actuelle de la médecine et aux attentes des patients. Mais pour que cela fonctionne, il faut un équilibre : un peu de souplesse, un peu de compréhension, et beaucoup d’écoute.
Je ne crois pas qu’il faille opposer les générations. Il faut trouver un terrain commun, ajuster le mode de fonctionnement du service à la réalité de chacun. Dans beaucoup d’hôpitaux, on observe des chocs générationnels : des changements de direction, des départs, des réorganisations… C’est parfois déstabilisant, mais cela fait aussi évoluer les choses.
La médecine change, c’est un fait. On parle beaucoup de surconsommation des soins, de nouvelles attentes sociétales, de rythme de travail différent. Ces transformations, on ne peut pas les ignorer. Travailler entre générations, c’est une façon d’accompagner ce changement — ensemble, plutôt que chacun de son côté. »
Différences générationnelles dans les professions médicales libérales
Les écarts entre générations ? Ils sont bien moins marqués qu’on ne le croit ! Découvrez ce qui rapproche les médecins, au-delà des clichés.
Téléchargez la brochure