Médecine en mutation : transmission et transformation
Docteur Jean Creplet (82) d’abord ingénieur, devient médecin puis cardiologue. Il a dirigé le département de médecine de l’Hôpital Bracops et le service de cardiologie du CHU de Charleroi. Il est l’auteur de nombreuses publications.
Aujourd’hui, avec le recul, je continue à réfléchir à ce métier que j’aime profondément, à ses évolutions, à ses paradoxes.
Dr Jean Creplet
Vous avez connu une autre époque de la médecine. Que pensez-vous de la quête d’équilibre des jeunes médecins aujourd’hui ?
Je comprends parfaitement ce besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Même si, à mon époque, le workaholisme médical était la norme, je ne le vivais pas comme une contrainte. J’étais comme un poisson dans l’eau. Les gardes de 72 heures, les journées sans fin… c’était notre quotidien, et nous l’acceptions sans broncher.
Mais cette contradiction entre mon vécu et la quête d’équilibre des jeunes générations n’est qu’apparente. Ce que je vois, c’est une liberté qui s’exprime différemment selon les époques. À chaque génération, ses contraintes, ses idées dominantes, ses défis techniques. Aujourd’hui, les jeunes médecins exercent leur liberté en revendiquant du temps pour eux, pour leurs proches, pour leur santé mentale. Et c’est une saine réaction.

J’ai toujours pensé qu’il nous fallait une grille de lecture pour comprendre la médecine dans sa complexité : les lieux de pratique, les étages bureaucratiques, les sphères politiques. Cette grille m’aide à comprendre les jeunes, à voir au-delà des tensions générationnelles. Car ce qui nous unit — notre passion pour le soin — est bien plus fort que ce qui nous sépare.
Comment avez-vous vu évoluer la charge administrative au fil de votre carrière ?
Au début, la charge administrative relevait de la discipline personnelle : dossiers, lettres, rapports. Puis les bureaucraties se sont multipliées, dictant nos gestes, nos décisions, nos attitudes. C’est la loi de Parkinson : elles libèrent au début, puis paralysent.
Je ne suis pas anti-administration. Mais aujourd’hui, les médecins sont ligotés par des procédures qui les éloignent de leurs patients. L’informatique, censée nous aider, est devenue un outil de contrôle. Elle façonne nos esprits, souvent au détriment de la relation humaine. Et ce phénomène dépasse la médecine : dans tous les secteurs, les gens de terrain sont écrasés par des diktats venus d’en haut.
Ce qui m’étonne, c’est la tolérance aux aberrations informatiques. L’État, par son emprise sur les logiciels médicaux, façonne l’esprit des médecins. Parfois avec de bonnes intentions, mais souvent avec des effets pervers. Il faut retrouver le courage clinique, celui de décider ce qui est bon pour le patient, sans devoir passer par des avals de toutes sortes.
Face à cela, je reste optimiste. Je crois que les utilisateurs — nous, les médecins — finiront par exiger des outils plus adaptés, plus intelligents. À nous de réfléchir à nos priorités, à ce que nous voulons préserver : le temps clinique, l’écoute, le jugement médical.
Que pensez-vous du phénomène du « stop patientèle » chez certains jeunes médecins ?
Je suis partagé. Certains refusent de nouveaux patients pour préserver la qualité de leur travail. D’autres restent disponibles à toute heure. Il y a un éventail d’attitudes, et c’est normal. Mais ce que je défends, c’est une médecine accessible, humaine et durable.
Ce qui m’inquiète, c’est l’idée que l’on puisse justifier un refus de nouveaux patients au nom de la qualité, sans chercher d’alternatives. Il faut trouver des équilibres organisationnels, réfléchir aux effectifs, à la répartition des tâches, à l’usage intelligent de la technologie. Et surtout, préserver la diversité des pratiques.
Comment garantir une médecine accessible et durable dans ce contexte ?
C’est la question la plus importante. Depuis des siècles, la solidarité spontanée a précédé la solidarité institutionnelle. Notre système de santé, tel qu’il s’est construit depuis 1944, respecte cette diversité. Il permet à chacun — médecin comme patient — de trouver sa place, selon ses convictions, ses besoins, ses moyens.
Mais cette liberté doit être préservée. Et pour cela, il faut consolider la solidarité par la liberté, et l’équité par une meilleure compréhension des rôles respectifs des autorités et des praticiens. Toute solution imposée d’en haut, unique et rigide, mènera aux extrêmes. Regardez le système de santé anglais : le NHS est au bord du précipice. Les patients qui en ont les moyens préfèrent venir se faire soigner en Belgique.
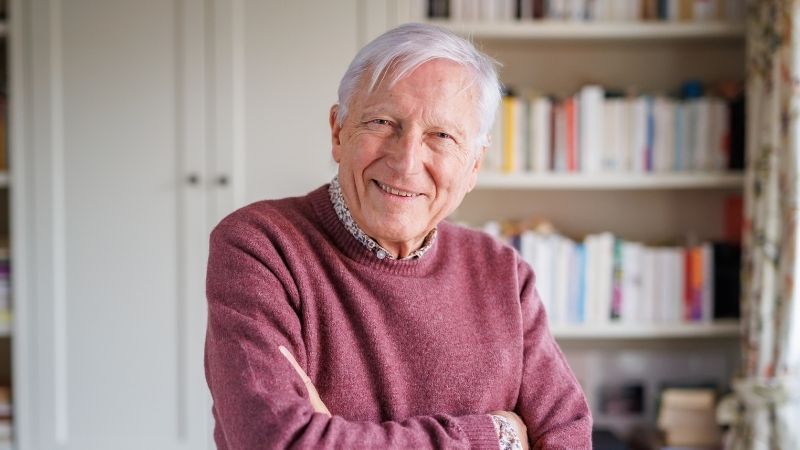
Les jeunes médecins ressentent une pression plus forte. Est-ce une question de tolérance ou d’organisation ?
Je ne crois pas que ce soit une moindre tolérance. Les excès des gardes sans fin devaient être corrigés, et c’est une bonne chose que les stagiaires aient aujourd’hui des temps de récupération. Mais il faut distinguer deux types de charge : la charge médicale, liée à la disponibilité pour les patients, et la charge administrative, imposée par des procédures souvent absurdes.
Les médecins et les infirmiers doivent être auprès des patients, pas derrière des écrans. Et ce discours est difficile à faire entendre, car les bureaucrates sont nombreux et influents.
Le burn-out est-il en hausse chez les médecins, et touche-t-il davantage les jeunes praticiens ?
C’est une question délicate. Je crois que, de tout temps, il y a eu des médecins en souffrance. Des praticiens isolés, mal à l’aise dans leur rôle, pour des raisons multiples. Ce n’est pas nouveau. Mais aujourd’hui, on en parle davantage, et c’est une bonne chose.
Un psychiatre des années 30 disait que certaines maladies sont le reflet d’une société qui ne va pas bien. Je pense que les relations hiérarchiques déplorables, dans la médecine comme ailleurs, sont une des grandes causes du burn-out. Mais il ne faut pas oublier que notre métier est fait d’imprévus. Chaque patient arrive avec ses surprises, ses préférences, ses réactions. Cela demande au médecin de se renouveler sans cesse. Il faut une certaine disposition personnelle pour cela.
Les relations humaines sont fondamentales : avec les patients, les collègues, les infirmiers, les autres professionnels de santé. Et puis, il y a les forces sociales, administratives, politiques… C’est beaucoup à gérer pour les gens de terrain. Nous sommes profondément impliqués dans ce qui arrive à nos patients. Contrairement à ce que certains pensent, les médecins portent leurs décisions longtemps. On dit souvent que nous avons deux cimetières en tête : celui du « j’aurais dû » et celui du « je n’aurais pas dû ». Ce sont des pensées qui nous habitent, parfois longtemps après une décision.
Et pourtant, on ne nous apprend pas à être modestes. Dire « je ne comprends pas, je vais demander à un autre », ce n’est pas dans la culture médicale. C’est dommage.
Heureusement, des initiatives existent. L’association Médecins en difficulté accompagne les praticiens en souffrance : burn-out, dépression, isolement. Elle propose du coaching, de la prévention. C’est une démarche précieuse, qui mérite d’être soutenue.
Comment percevez-vous les différences entre générations de médecins ? Sont-elles un frein ou une richesse ?
Dans une société libre, les expériences positives tempèrent les moins bonnes. J’ai eu la chance de vivre plusieurs contextes : hôpitaux publics à Bruxelles et Charleroi, cabinet privé, polyclinique du Chirec. Après dix ans, j’ai été confronté à un règlement de limite d’âge. Sur le moment, je l’ai mal vécu. Mais avec le recul, cela m’a permis de rebondir, de rejoindre un cabinet proche de chez moi, tenu par un collègue plus jeune. Il avait été mon stagiaire en cardiologie trente ans plus tôt. Vous voyez, il y a des histoires formidables entre générations.
Je crois beaucoup à la complémentarité. Jeune, j’étais enthousiaste pour les nouvelles techniques. Avec l’expérience, je suis devenu plus prudent. Aujourd’hui, les deuxièmes avis se multiplient, surtout pour les traitements complexes chez les personnes âgées. Cela oblige toutes les générations à réfléchir ensemble, à confronter leurs points de vue.
Mais il y a aussi des préjugés tenaces. Dans certaines hiérarchies médicales, on se croit supérieur aux autres. Dans les facultés, après six ans d’études, certains professeurs disent aux jeunes diplômés : « vous êtes des docteurs de rien ». Les spécialistes méprisent parfois les généralistes, les généralistes critiquent les spécialistes, et les spécialistes se critiquent entre eux. Ce sont des attitudes infantiles, qui n’ont pas leur place dans une profession où la coopération est essentielle.
Le réseau informel entre médecins semble s’effacer. Quelle importance avait-il dans votre pratique ?
Le réseau informel est essentiel. Il repose sur le patient, qui fait le lien entre les différents médecins. Avant, un petit bout de papier suffisait pour transmettre l’essentiel. C’était simple, humain, efficace. Je crois encore à ces collectifs à taille humaine, créés par les individus eux-mêmes, sans lourdeur administrative.
Aujourd’hui, les photos de rapports ou de boîtes de médicaments circulent sur les téléphones. C’est une forme de communication nouvelle, mais elle reste personnelle. Ce qui me manque, ce sont les échanges spontanés, les coups de fil entre généralistes et spécialistes, les discussions informelles. La digitalisation a structuré la coordination, mais elle l’a aussi rendue plus distante.

La médecine s’est fortement féminisée. Est-ce que cela influence la manière d’exercer ?
Les déséquilibres doivent être corrigés, et la féminisation de la médecine est une bonne chose. Mais ce n’est pas propre à notre métier. Dans tous les domaines, les femmes ont dû se battre pour équilibrer les choses. Le patriarcat reste dominant, et le machisme n’a pas disparu.
Je pense que plus il y a de femmes dans le management médical, plus cela peut apporter une forme d’apaisement, une autre manière de gérer. Les femmes veulent parfois plus de temps pour leurs enfants, pour leur vie privée. Et c’est très sain. Cela influence la manière d’aborder le métier, bien sûr, mais dans le bon sens, j’espère.
Qu’est-ce qui unit les générations de médecins, malgré leurs différences ?
Ce qui nous unit, c’est la passion du métier. Mais cette passion se manifeste différemment selon les caractères. Certains médecins sont fascinés par la technique, très bons dans leur spécialité, mais peu portés sur la relation humaine. D’autres sont là pour le contact, pour le lien, mais parfois au détriment de la rigueur clinique. Tous aiment leur métier, mais selon des angles différents.
Ce qui nous manque, c’est une compréhension commune des forces sociales qui agissent sur notre profession : politiques, commerciales, administratives. Nous devons apprendre à nous définir face à ces forces. Et cela commence par le dialogue entre nous.
Les généralistes, par exemple, ont aujourd’hui une position renforcée. Ils gagnent mieux leur vie, ils ont un rôle central à jouer. Leur force, c’est leur carnet d’adresses, leur capacité à orienter les patients vers les bons spécialistes. Mais peu le font encore. Pourquoi ? Parce que les contacts entre généralistes et spécialistes sont difficiles. Pourtant, c’est une voie à développer.
Les spécialistes aussi devraient réouvrir leurs antennes, mieux communiquer entre eux. Car au fond, nous avons tous les mêmes questions : « Que puis-je faire pour ce patient ? Et comment préserver du temps pour moi ? » Trouver cet équilibre, ce n’est pas simple, mais c’est essentiel.

En conclusion
La médecine est un métier de liberté. Une liberté de jugement, de décision, de relation, toujours avec son lot de responsabilités. Et cette liberté doit aussi être celle du patient. C’est ce qui fait la richesse du système belge : la diversité des pratiques, des lieux de soins, des approches. Vous voulez un médecin très technique ? Vous le trouvez. Vous préférez un cadre plus collectif, plus accessible ? Il existe aussi.
Cette liberté de choix, pour le médecin comme pour le patient, est un trésor. Et c’est elle qui nous permettra, malgré les tensions, de continuer à exercer ce métier avec passion, humanité et responsabilité.
Différences générationnelles dans les professions médicales libérales
Les écarts entre générations ? Ils sont bien moins marqués qu’on ne le croit ! Découvrez ce qui rapproche les médecins, au-delà des clichés.
Téléchargez la brochure